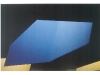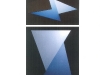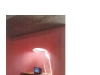E. et L. Beaudouin
Auteur : MAXIME CAMARA
La première question porte sur la création et sur l’architecture : si vous aviez à défendre le statut ou la place de l’architecte dans le processus de construction actuel, quels arguments utiliseriez-vous?
D’une manière générale, je ne m’intéresse pas à la profession en tant que statut. Ce qui m’intéresse c’est la place de l’architecture dans la société. L’architecture a une responsabilité sociale, une influence directe sur le développement de la ville, sur la vie humaine, le bien-être. Elle s’inscrit aussi dans une évolution à long terme. C’est un moment dans une chaîne de transformation de la société. Ce n’est qu’un moment de cette transformation et pas un moment définitif. Elle se place dans une transformation globale de la ville, de la civilisation dont l’évolution est lente et l’architecture évolue avec cette lenteur. C’est pour cette raison que je ne crois pas à l’influence réelle de la mode sur l’architecture. Il faut chercher ce qui fait, en profondeur, la permanence du projet afin qu’il survive à une évolution à long terme. S’inscrire de manière tranquille dans un mouvement qui a commencé avant nous et se poursuivra après nous.
Croyez-vous qu’il existe encore aujourd’hui un réel désir d’architecture? Ressentez-vous un décalage entre les interrogations de l’architecte et les volontés d’architecture d’une société?
Il existe peut-être des désirs, mais il n’y a pas de demande formulée explicitement. Ce qui relève du désir est une demande d’expression considérée comme relevant de l’esprit du temps, de l’innovation technique, de l’idée que l’on peut se faire de l’avant-garde, etc… Ce n’est pas ce type de désir qui nous intéresse. Souvent, on se situe très loin de ce qu’imagine le client comme étant la chose la plus en pointe. Notre travail recherche un dialogue avec des interrogations constantes. Le bâtiment n’est pas éternel, mais les questions posées à l’architecture sont permanentes. Le langage architectural est d’une certaine manière une langue internationale qui n’a pas de frontière parce que justement il renvoie à des choses qui sont extra culturelles. Par exemple le rapport de l’architecture à la nature. La manière d’utiliser le soleil est un problème qui n’a pas de frontière même si le soleil est d’une intensité différente en France et au Brésil. La gravité est également une question posée éternellement à l’architecture qui ne répond pas à une demande particulière du client. Pour lui, cela semble une évidence sur laquelle il n’y a pas à réfléchir, il suffit de calculer. Or, pour l’architecture, la gravité est une question majeure, ce n’est pas un problème technique.
La lumière, la nature, la gravité comme éléments essentiels de l’architecture s’adressent alors à une sensibilité universelle?
Cette demande ne fait pas partie des programmes que l’on transmet aux architectes. Ce n’est même pas une volonté c’est une confrontation obligatoire. Parfois, au final, cela passe inaperçu parce que de toute façon la lumière du soleil éclaire le bâtiment et qu’il tient debout. Le soleil et la gravité sont utilisés même pour construire un château de sable. Mais si l’on en tient compte, si l‘on dialogue avec ce genre de problème, on peut s’exprimer à partir des interrogations que cela pose à l’architecture. Explorer ces questions pour les rendre présentes, sensibles, voire même en faire des instants d’émotion, cela fait partie du travail de l’architecte, de la chose en plus apportée au bâtiment. Faire sentir physiquement des évènements naturels, est devenu une nécessité en raison de la dimension artificielle qu’à pris l’évolution de la société. Plus l’homme est pris dans l’artifice de la consommation, de la technique, plus il a besoin d’un ancrage, d’un contrepoids qui lui rappelle son appartenance matérielle au monde. Plus la société va devenir artificielle, plus le rapport à la nature, dans toutes ses dimensions, va devenir essentiel. L’homme est un animal sensible.
Comment placez-vous l’homme face à sa conscience du temps à travers votre architecture?
Une des responsabilités de l’architecture est de ralentir le temps. Elle est le lieu de la dilatation du temps, celui où il peut changer de dimension et s’épanouir. La vie sociale a tendance, depuis très longtemps à donner au temps et à sa perception une sorte d’accélération. Pourtant le temps qui, apparemment est une donnée objective, n’est pas socialement toujours perçu de la même manière. Quelqu’un vivant dans le stress a l’impression que le temps s’écoule très rapidement et tout est organisé autour de lui pour le lui faire percevoir. Entre une horloge et une montre, la différence est dans la petite aiguille et lorsqu’on la regarde, le temps bouge extrêmement vite. On a une visualisation très précise du temps qui passe. Le temps semble insaisissable. Autrefois il n’était pas rendu visible à ce point. Jamais une horloge ou un cadran solaire ne montrait l’écoulement du temps de manière aussi physiquement sensible. Le mouvement de la lumière naturelle rend visible la présence du temps dans l’architecture. Le soleil est la seule chose qui fasse changer réellement l’architecture. Le bâtiment évidemment ne bouge pas mais le soleil le transforme avec la lenteur du temps naturel. L’architecture exprime le temps ralenti de la nature et cela nous fait du bien. Plus la société nous pousse à agir vite, à nous déplacer rapidement, plus le contrepoids d’espaces où le temps naturel s’écoule tranquillement est nécessaire. Cela nous fait le même bien physique et mental, que le moment où l’on s’attarde au bord de la mer pour voir le soleil se coucher. L’architecture a ce pouvoir, en nous révélant le temps naturel, de nous calmer, d’être l’antidote à l’écoulement trop rapide du temps social. La nature s’exprime à travers le jeu architectural. Les grands architectes modernes comme Tadao Ando l’ont compris. L’expression de la lenteur est importante dans la perception de l’architecture d’Ando. C’est une partie des choses que j’ai apprises de lui. Une autre question est ce que l’on appelait au début du siècle la « quatrième dimension » : le temps et l’espace comme deux choses en continuité. Il s’agit alors non plus d’un rapport unique à la nature mais d’un rapport à l’espace lui-même. C’est le temps du parcours, de la promenade architecturale, qui va construire la succession des espaces dans le projet. On n’a jamais souhaité faire des bâtiments qui soient compréhensibles complètement d’un seul point de vue. Le corps va se déplacer dans le bâtiment, le point de vue privilégié de la perspective de la Renaissance, n’est plus un point de vue unique. L’enchaînement de ces séquences « cinématographiques » est la manière de faire ressentir ce temps spatial et continu. Il s’agit d’une succession d’ordre un peu dramatique où le temps va s’exprimer à travers des espaces à caractère différent. Cette volonté influe sur la forme du projet, car elle nous oblige à réfléchir à des espaces majeurs, ouverts, devant correspondre à des éléments importants du programme. Dans une bibliothèque, par exemple, le hall et la salle de lecture peuvent être mis en articulation l’un par rapport à l’autre, en donnant à chacun un caractère spécifique. Cette transition est toujours un instant de tension, un moment fort où le corps va sentir l’espace devenir plus petit, changer de géométrie ou de direction. La rampe est un élément propice pour faire basculer de cette façon d’un espace à un autre. Elle est le lieu de la continuité. La situation idéale est d’aboutir à un lieu extérieur à la fin du parcours. L’impression d’immensité que l’on a dans un espace extérieur, soulevé sur le toit d’un bâtiment, est plus forte parce que le dégagement est plus long. On peut voir le soleil toucher l’horizon, ce qui n’est pas forcément le cas au sol. Évidemment tout ce dont on parle, la rampe et le toit terrasse, ne sont pas des inventions récentes. Ce sont des points décrits de manière incroyablement claire par Le Corbusier depuis le début. Mais cette leçon de Le Corbusier n’a pas été retenue malgré son évidence.
Considérez-vous alors que l’architecture, face à l’évolution de nos sociétés, représente une valeur refuge et à l’extrême ne risque t-elle pas de se couper d’un monde en pleine mutation en défendant des valeurs comme la recherche d’un temps perdu ou d’une certaine perception plus humaniste du cosmos?
Il faut bien comprendre ce que j’essaie de dire. Ce n’est pas une critique réactionnaire vis-à-vis de l’évolution des technologies. Au contraire nous l’utilisons sans problème dans les bâtiments et dans notre méthode de travail. Ce n’est pas une réaction «anti», qui voudrait freiner l’évolution de la société. C’est une volonté d’équilibre. Si la société n’était que virtuelle, si les rapports n’étaient plus que des rapports de communication à distance, on finirait tous par être malades, c’est comme s’il n’y avait plus que de l’amour virtuel entre les hommes et les femmes. On a besoin du corps de la femme et pas seulement de son image. De même, le rapport physique à l’architecture ne sera jamais remplacé par une quelconque apparence. On sera toujours dans un rapport avec le bâtiment où le corps aura une présence. Les cinq sens ne seront pas supprimés par l’évolution technologique. Par contre, elle nous permet d’engager des relations avec le lointain qu’on ne pouvait pas entretenir auparavant. C’est comme les grandes découvertes. Mais plus les distances diminuent du fait de l’évolution technologique, plus l’espace architectural devrait dilater la dimension du réel, plus l’aisance de l’architecture devrait nous donner du bien-être.
Qu’évoque alors pour vous l’idée du Beau, du Vrai et de l’Authenticité?
Il existe un texte magnifique d’Ozenfant sur la question du Beau. Il montre que l’idée que l’on peut se faire du Beau a évolué et en particulier a radicalement changé au début du siècle. L’idée classique du Beau, d’après lui, était liée à la notion de plaisir. Le Beau agréable satisfaisant les sens avec une dimension positive. Il explique que l’idée de la beauté peut englober aujourd’hui un type d’émotion qui n’est pas forcément de l’ordre de l’agréable. Il suffit de penser à Picasso pour comprendre que certains de ses tableaux ne sont pas agréables. Ils s’adressent à l’émotion aussi bien positive que négative. Ces émotions peuvent être troublantes, fortes, impressionnantes. Le XXème siècle a élargi considérablement la notion de Beau. Il n’a plus comme critère le simple plaisir mais l’émotion avec les diverses intensités de couleur, de force que l’on peut y introduire. Le Corbusier parlait en permanence d’émotion dans ses textes, plus que du Beau en tant que tel. Nous nous situons, d’une certaine manière, toujours dans cette vision très large de la beauté. Les bâtiments de Siza, par exemple, ne sont pas réellement harmonieux. Lorsque l’on suit la genèse de son travail, lorsque l’on voit les maquettes, les plans du début, on est toujours étonné, on a une petite inquiétude et l’on se dit mais que fait-il, à quoi ça ressemble, quelles sont ces proportions étranges? Or le résultat de tout cela est une émotion qui est largement au-delà de l’harmonie habituelle, même si Siza est un architecte où l’idée classique de la beauté est très présente. Je pense qu’il a élargi cette dimension de la beauté à des émotions physiques. C’est une architecture où la présence du corps est très importante. Pour répondre maintenant à la question du Vrai, je dirais qu’on ne s’en est jamais préoccupée dans les projets. La distance entre la vérité et le mensonge est trop étroite pour l’architecture. La clarté me semble plus importante que la vérité. La question se pose, par exemple, dans la construction. La clarté de la construction me semble une chose fondamentale. Mais pas forcément la vérité constructive qu’ont revendiquée les architectes modernes. En fait personne ne l’atteint jamais. Même Mies Van Der Rohe n’est pas dans l’ordre de la vérité constructive pure. Les poteaux de la villa Farnsworth ne sont pas en dessous de la dalle du bâtiment. La dalle frôle les poteaux comme s’ils ne la portaient pas. Même quelqu’un extrêmement pur comme Mies, n’est pas dans l’expression de la vérité constructive. N’importe quel ingénieur aurait mis les poteaux sous la dalle. Il est dans l’expression de la clarté de l’intention architecturale. Dans le Musée des Beaux-Arts de Nancy, une partie des structures est rendue visible, une autre ne l’est pas. Le choix entre ce que l’on montre ou pas, est l’endroit où se situe le rapport entre la clarté et la confusion et pas entre la vérité et le mensonge. On a souhaité que seules les poutres, ayant un rôle à la fois structurel et spatial, soient rendues apparentes. D’autres, uniquement d’ordre structurel, sont englobées dans le volume du bâtiment. L’autre élément important du Musée, qui échappe à la vérité constructive, c’est le grand mur de la façade, suspendu au dessus du jardin. Ce mur est hétérogène dans sa construction. Toute la façade jardin est en béton. Or la partie pénétrant dans le bâtiment ancien, en porte-à-faux sur 7 mètres à l’intérieur, est une ossature en acier. L’ensemble est réuni sans que la différence entre les deux matières structurelles soit rendue visible. Il s’agit bien d’une vérité cachée sur le plan de la construction. Mais l’expression de la présence abstraite de la gravité nous semblait plus importante que celle de la construction propre du mur. Ce mur a un degré d’abstraction prioritaire par rapport à sa réalité matérielle. Par ailleurs, ce mur n’est pas seulement suspendu. Il n’est pas un masque devant la façade du bâtiment. Il est accroché à un réseau de poteaux mais en même temps il sert de poutre et porte les salles du premier étage sur un de leur coté. Ainsi ces salles suspendues au dessus des bassins ne sont portées que par un poteau sur l’angle. Ce mur suspendu devient mur porteur. Il est à la fois dans l’espace et porteur.
Quel rôle joue selon vous le croquis et le trait dans le processus de création?
Le trait et le croquis sont deux choses un peu différentes mais qui sont évidemment en rapport. La question du trait est plus large que celle du croquis. Tu peux avoir des croquis qui ne sont pas des traits. Le trait est plus précis. Il est une qualité. L’illustration la plus frappante pour moi est la manière dont certains peintres chinois parlent de la qualité que devrait atteindre le dessin. Je pense en particulier à Chin Tao. Il utilise pour cela l’expression magnifique de « l’unique trait de pinceau ». Le trait devient, par son unicité, l’unité du bâtiment. L’unité est une des qualités du projet. Je ne crois pas à l’éclectisme. Je pense que la variété et l’unité sont deux qualités de l’architecture qui sont parallèles et dialoguent dans le projet. J’œuvre en permanence pour que les croquis et les bâtiments aient cette qualité. Pour les croquis, j’utilise plusieurs outils, pas seulement le crayon mais aussi le pinceau. Peut être en hommage aux peintres chinois, mais aussi parce que le pinceau a la capacité d’être un trait exprimant des diversités dans la continuité. Le trait participe à la conception du bâtiment, à l’idée qu’on se fait de l’architecture. Le croquis relève plutôt de la méthode de travail. L’importance du croquis s’exprime dans le fait que la pensée et la main sont en dialogue permanent. La pensée a besoin de voir ce qu’elle pense. La main a aussi la capacité d’introduire le hasard dans la conception. Les proportions sont souvent révélées par le croquis comme une chose inconsciente. Or les plans et les coupes ne les rendent pas toujours visibles. L’autre aspect important du croquis est sa dimension sportive. C’est un entraînement indispensable c’est une pratique permanente qui devrait être développée par les étudiants depuis le début. Exactement comme le chanteur a besoin d’utiliser ses cordes vocales et le sportif d’entraîner ses muscles. Le croquis a aussi un rôle purement mécanique: il installe la pensée dans une situation ouverte. Matisse dessinait une quantité d’esquisses avant un tableau. Il savait pertinemment qu’elles n’étaient même pas la chose qui préparait l’œuvre. Ce sont des recherches qui vont au delà de ce qu’il cherche à voir et à représenter. Ces recherches d’apparence gratuite, vont enrichir l’œuvre pour aboutir à un unique trait de pinceau. Mais ce trait de pinceau est l’aboutissement d’un travail extrêmement long de répétition du croquis et pour que la forme atteigne sa maturité.
Quel est votre méthode de travail?
Les projets sont étudiés avec ma femme Emmanuelle. Le croquis nous permet de dialoguer très vite pour se mettre d’accord sur des objectifs. Il intervient comme un troisième interlocuteur. Les décisions sur le projet ne sont jamais l’objet de discussions très longues. Le croquis permet de décanter les choses puis l’ordinateur peut enregistrer rapidement les conséquences de ces évolutions. C’est au début que tout se joue. Les projets ont toujours un point de départ assez rapide et les premières esquisses sont toujours très proches du résultat final. Le reste du travail est la tentative d’atteindre l’idée ensemencée dans les tous premiers moments du projet. Cela rejoint les propos de Kahn : «I love beginings». Ce sont les instants les plus délicieux du travail où les idées arrivent sur le papier à travers l’expression de la main. Il y a pourtant une période qui précède ce travail, une période où le projet « mijote » dans la pensée sans aucun dessin. Cette période, quelque fois, a besoin d’être longue.
Existe-t-il dans vos dernières réalisations un projet qui vous semble exprimer une réflexion complétement développée?
Franchement c’est difficile à dire, car notre démarche s’inscrit dans une continuité. Ce n’est pas une succession de bâtiments, mais plutôt des familles de projets même si le travail a évolué depuis quelques années. Je veux dire que l’importance de certaines choses est apparue malheureusement assez récemment. On a par le passé, négligé certains aspects, qui nous apparaissent aujourd’hui extrêmement importants. Par exemple la question des proportions. La qualité des proportions ne doit pas être étudiée à la fin du processus d’élaboration d’un projet mais bien être présente dès le départ. Il existe un stade d’équilibre minimum que j’espère mieux maîtriser maintenant. Puis il existe une dimension au delà de ce minimum qui est très difficile à atteindre. Seuls certains architectes de caractère exceptionnel y parviennent comme Le Corbusier ou Alvaro Siza. Si l’on regarde les bâtiments de Siza, on a beaucoup de mal a en saisir les proportions. Il y a beaucoup de dimensionnements très étranges dans ses projets et c’est cette étrangeté qui fait la beauté du bâtiment. Non pas parce qu’ils sont mal proportionnés mais parce que les proportions ne sont pas forcément celles que l’on attend. Certaines dimensions sont dilatées par rapport à des proportions habituelles ou au contraire des petites choses sont plus petites encore que ce que l’on pourrait attendre. Il y a un réel travail qui va au delà de la proportion classique de l’architecture. C’est en cela que son architecture est d’une modernité extrême. Elle atteint ce niveau d’émotion dont on parlait. Ce n’est pas forcément beau au sens classique mais cette étrangeté est extrêmement émouvante. La dernière chose qui a changé dans notre travail c’est l’introduction de la matière comme présence physique. Pas le matériau mais la matière brute. Les premiers projets avaient une dimension assez abstraite, c’étaient des bâtiments blancs. Un jour Luigi Snozzi m’a demandé: « pourquoi fais-tu des bâtiments blancs? ». En fait ce n’était pas une volonté d’être blanc, mais plutôt une absence de réflexion sur ce sujet. Il y avait déjà tellement de problèmes à résoudre que cette question de la matière avait été mise de coté. On l’utilisait de manière très succincte. Ce n’est que depuis quelques années que cette question a été introduite dans les bâtiments. Les projets les plus récents, comme celui de Besançon, sont construits avec une pierre qui a une épaisseur, c’est de la pierre massive, maçonnée. Elle est utilisée non pas pour exprimer l’idée de richesse, de fiabilité, ou d’éternité, mais elle est introduite comme force pour donner à l’architecture une dimension naturelle. La dimension d’un objet participant à la nature. L’ architecture devrait être un morceau de la géographie et pas seulement un instant de l’histoire. L’architecture est trop souvent perçue uniquement comme faisant partie du patrimoine historique. On est couvert de règlements qui renvoient à des dispositions historiques ou à la position de l’architecture par rapport à l’histoire. Or personne ne nous demande d’être en rapport avec la géographie.
Pourriez-vous nous parler de la manière dont vous traitez le contexte urbain et historique, la distance que tu vous prenez par rapport au patrimoine dans vos projets. On se trouve peut-être aujourd’hui entre deux extrêmes. Nous sommes parfois coincés entre la notion de tabula rasa et celle de qui a tendance à poser des cloches hermétiques sur des morceaux de ville. Cette attitude finit par figer des entités qui à travers le temps ont évolué, se sont enrichies de productions en phase par rapport à une époque donnée.
Nous n’avons jamais été favorables à la notion de « tabula rasa ». Vous décrivez la situation actuelle en Europe où cohabitent sans problème, sans état d’âme les deux extrêmes. Ceux qui sont en charge de la protection du patrimoine, ont une vision très XIXème siècle de l’histoire. Ce qu’on essaie de sauvegarder c’est l’image de ce siècle dans l’architecture. On juge arbitrairement absurde l’idée de faire un bâtiment qui aurait par exemple l’autonomie, la fantaisie d’une architecture romane. Ce que l’on demande dans les secteurs sauvegardés c’est de faire une architecture d’accompagnement, sage et si possible non référencée. L’autre extrême est le fruit de la paresse. On préfère tout nettoyer et prendre le projet à partir de zéro. On pense alors que c’est une manière plus libre de faire de l’aménagement urbain. Entre ces deux extrêmes il y a une pratique de l’architecture un peu au fil du rasoir, tenue dans un équilibre difficile à atteindre. Le temps accordé à ce type de travail devrait avoir une certaine importance. On ne peut pas produire instantanément des projets qui tiennent compte de la complexité de la ville. Il faut accorder du temps à l’architecture. Ces deux dimensions, géographiques et historiques permettent de se maintenir sur ce fil du rasoir et d’échapper à la question de l’imitation, ou du langage historiciste qui est la solution de facilité que tout le monde souhaiterait voir se développer dans ce genre de situation. Encore une fois, même vis à vis de la présence urbaine, la clarté me semble une qualité qu’une vérité historique ne pourrait pas atteindre à elle seule, pas plus qu’un mensonge historiciste. Il faut arriver à être juste, si on donne au mot juste son sens musical. Si vous entendez une musique et que vous vous mettez à chanter, si vous chantez juste, cela crée une unité et un équilibre. C’est cette justesse que l’on essaie d’atteindre.
Avez-vous l’impression que le Musée des Beaux-Arts arrivera comme l’aboutissement d’une production architecturale à Nancy?
Le Musée des Beaux-Arts représente dix années de travail et nous pensons qu’il s’inscrit dans l’histoire et la tradition architecturale de la ville. Mais un bâtiment n’a jamais une seule raison d’être. Avoir des sources qui proviennent de courants multiples est une qualité pour un projet. Parmi les sources qui sont à l’origine de ce travail, certaines n’ont rien à voir avec le lieu, avec l’histoire de la ville, même rien à voir avec l’architecture. C’est par exemple l’image de cette fresque de Florence représentant la Cène peinte par Andrea del Castagno où l’on voit une grande table au-dessus de laquelle apparaissent le Christ et les Apôtres. Cette table est un rectangle pratiquement parfait, d’un blanc pur, de proportion très allongée. Elle semble flotter d’une manière abstraite dans un espace libéré de toute pesanteur. Andrea del Castagno a montré les piliers qui portent la table mais il les a estompés dans des couleurs sombres. La table se trouve alors en suspension.L’exemple de cette oeuvre a servi pour conforter l’idée de la façade principale du Musée. Une autre image plus moderne est celle du «Délinéator» de Richard Serra, une sculpture dans laquelle on est face à deux grandes plaques de métal, une posée au sol et l’autre suspendue au plafond. Ce sont des rectangles qui ont des directions orthogonales inversées. Ils créent une tension forte qui nous aspire physiquement. Cela nous a permis d’installer par rapport à cette façade, qui était le point de départ du projet, deux autres plans, qui ont à peu près les mêmes proportions que la façade elle-même. Une grande dalle de granit sombre, simplement posée au sol et un plan abstrait suspendu qui vient frôler à l’intérieur du bâtiment la façade elle-même. On a donc trois plans en tension et ces trois plans définissent complètement l’architecture du Musée. On rejoint là l’idée de l’unique trait de pinceau. Ces deux sources n’ont rien à voir avec le lieu, cependant le fait de mettre en valeur la gravité de cette manière, n’est pas sans rapport avec l’histoire de l’architecture de la ville. Le Musée est dans la continuité de l’ensemble réalisé par Emmanuel Héré au milieu du XVIIIème siècle. Lorsqu’on analyse cette composition on voit une très forte évolution malgré l’apparence unitaire de l’ensemble, entre l’expression architecturale de la Place Stanislas et l’expression développée par Emmanuel Héré à la fin de sa vie, à l’autre extrémité de la Place Carrière. La première partie de son travail est très théâtrale, basée sur l’apparence des éléments de façade qui constituent ce décor où les éléments architecturaux sont comme des masques devant les fragments de la ville qui viennent jusqu’à la Place. C’est le cas du Musée qui vient regarder la Place à travers le masque de la façade d’Emmanuel Héré. Mais si l’on regarde l’œuvre de la fin de sa vie, à l’autre bout de la Place Carrière où il a construit le Palais de l’Intendance, on voit un bâtiment qui n’est plus du tout un masque, qui est une structure spatiale formée d’un grand rectangle simple et horizontal, suspendu sur une colonnade ouverte sur le parc. Cette grande innovation d’Emmanuel Héré a été malheureusement effacée par ses successeurs. L’extension du Musée des Beaux-Arts, même s’il est pour nous l’aboutissement d’un travail sur le plan libre, développé durant mes années d’enseignement auprès d’Henri Ciriani, se situe aussi et sans que cela soit contradictoire, dans la continuité des idées de cet architecte du XVIII° siècle. C’est une autre manière de ralentir le temps.