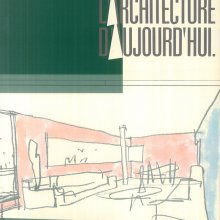
HENRI CIRIANI
Auteur : LAURENT BEAUDOUIN
L’Historial de Péronne est dans l’œuvre d’Henri Ciriani, non pas un tournant ou une rupture, mais au contraire une pose, un temps dédié à l’épanouissement d’années de travail sur la question de la spatialité moderne. Péronne est un instant calme, complet, où la perfection semble aller de soi, sans le didactisme qui, par amour de la pédagogie, teinte d’autres projets. La leçon de l’Historial est une leçon cachée, enfouie dans l’épaisseur de ce qui en fait l’unité. Finalement, comme pour les bons films, il faudrait se laisser guider par le fil du projet, ne pas en connaître à l’avance le scénario et se laisser surprendre par la découverte du parcours. Comprendre ne devrait être qu’une étape ultérieure. D’ailleurs la subtilité des pièges installés par Ciriani, préserve le projet d’une défloration immédiate. Ici la tension entre l’apparente simplicité externe et la dynamique spatiale interne, apparaît comme extraordinairement contrastée et équilibrée. C’est cet équilibre qu’il m’intéresse de décrire ici. Il a ses propres sources dans l’oeuvre elle-même, dans le lent murissement d’une recherche patiente, dans un travail acharné d’amélioration de chaque angle de vue, jusqu’à ce que l’ensemble atteigne un état de fluide cohésion. Péronne est conçu dans une période où deux autres projets majeurs voient le jour: le Musée antique d’Arles et la Maison de la Petite Enfance de Torcy. Ces trois édifices, en traçant des sillons parallèles, ensemmencent des catégories thématiques nouvelles, définissant trois lignes de recherche fondamentalement différentes et complémentaires. En Arles, c’est l’absolu de l’abstraction qui nous autorise à penser à nouveau comme dans les moments les plus authentiques de l’histoire de l’architecture, qu’il n’y a pas de contradiction entre une géographie naturelle et une géométrie produite par la pensée pure, comme si cette pensée abstraite, qui nous définit comme être humain, était cristallisée et délicatement posée dans un paysage qu’elle révèle. Cette cristallisation de la pensée se fait sans concession au pittoresque, balayant d’un coup les années récentes où l’architecture s’est humilée dans l’imitation édulcorée et l’absence d’échelle. Arles est l’abstraction pure accueillant sur un fond bleu, comme les ciels d’une peinture de Sasseta, les éléments du paysage et ses propres espaces. Dans la Maison de la Petite Enfance, s’ouvre une autre voie, celle de l’espace pictural. Celle par laquelle va pouvoir se développer l’idée d’une architecture organisée non plus uniquement par le réel structurel mais par l’interaction de deux différences superposées: l’espace propre au construit et l’espace que définit la couleur. A Torcy, l’architecture est doublement constituée: le plein est occupé par la matière structurante, et le vide est rempli par la couleur. La superposition des deux crée un décalage donnant des profondeurs virtuelles, un espace nouveau, résonnant entre le vide et le plein, produisant comme des effets d’harmoniques. C’est l’espace pictural. La troisième direction de recherche est toute différente des deux premières, bien que chacun de ces thèmes contamine petit à petit l’ensemble de l’oeuvre. Parce que plus mystérieuse, plus poétique, il n’est pas possible de la résumer d’une seule formule. Disons que cela a quelque chose à voir avec la question de l’unité, avec l’espace continu. Une telle diversité de recherche n’est pas le reflet d’hésitations, mais la marque profonde de la capacité actuelle d’Henri Ciriani de répondre à la question de la ville non plus comme une unique mégastructure qui était propre à l’utopie sociale des projets des années 70, mais comme un ensemble architectural complexe et non contradictoire. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder le projet du Plessis-Robinson, et de revisiter parallèlement “La Noiseraie” à Marne-la-Vallée. Regarder la qualité de son vieillissement, se rendre compte que ce qui n’était qu’une force dimensionnelle au moment de la construction, dispense aujourd’hui une sérénité calme et rassurante. La somme de ces projets, avec les clés théoriques qu’ils proposent, forme un patrimoine intellectuel et construit, qui devrait pouvoir enfin échapper au caractère prototypal d’une programmation fragmentée, et prendre corps dans un grand dessein urbain. Le projet de l’Historial de Péronne, lui, n’est pas un prototype. Il est au contraire, intimement inscrit dans son paysage, dans un dialogue de réciprocité entre le naturel et l’artefact. Pour le visiter, il vaut mieux suivre le chemin des promeneurs du dimanche, ceux pour qui la visite du bâtiment n’est pas l’essentiel, mais plutôt l’aboutissement d’un après-midi à la campagne, ceux pour qui finalement il a été construit. Ce chemin fait le tour d’un étang bordé sur l’Ouest de sa berge d’une petite peupleraie. A travers les colonnes des arbres, la façade opaque de l’Historial se reflète sans ostentation. Elle se dresse comme un champ vertical planté de fines colonnes de marbre, elle flotte en drapeau au-dessus de l’eau, parcourue par les vagues successives des nuages nordiques. C’est la seule partie extérieure du projet qui évoque directement le programme dans son caractère dramatique, transcrivant à la verticale ces champs rectangulaires de l’Est et du Nord où des croix blanches s’alignent régulièrement pour rendre supportable l’horreur du nombre. Sa courbure accélère le mouvement des nuages qui déposent le temps par couches successives sur l’opacité du béton. Plus tard viendront les fines salissures qui dessineront des ombres temporelles à chaque cylindre de marbre. La matière blanche et crayeuse de l’Historial donne une dignité nouvelle à l’étang en lui offrant l’occasion de devenir miroir. Sans elle, il ne serait qu’un marécage bordant les douves d’un fort en ruine. Elle introduit de la vitalité dans la mélancolie. Plus on se rapproche du bâtiment, plus on le sent comme coulé d’une seule masse dans une matière puissante et homogène. Il se soulève au-dessus du plan incliné de la berge, comme pour mieux nous faire sentir la continuité entre ses façades et son incroyable sous-face de béton blanc. Moulé dans un seul bloc, recoupé par d’impeccables joints, il donne la même impression de plénitude matérielle qu’un temple grec. A l’endroit crucial du retournement de la façade vers la sous-face, associant le poteau à cette continuité, Ciriani trace le nécessaire et exact délignement qui donne la compréhension que nous ne sommes pas devant un revêtement. Ce tracé rigoureux est le témoin d’une appartenance à la culture méditerranéenne, celle qui se laisse encore dessiner, par respect et par amitié, par les éléments de la nature: la lumière du ciel sur des reliefs sortis de terre. C’est par la place qui s’ouvre vers la ville, que se fait l’entrée normale, celle des touristes pressés qui sortent de l’autocar. Les deux tours circulaires en briques forment un porche impressionnant, donnant accès à une cour à la géométrie incertaine. Le travail d’Henri Ciriani dans l’exercice périlleux d’écriture d’un dialogue entre un bâtiment neuf et un édifice existant est une démonstration de justesse par rapport à l’échelle de l’ensemble. Une équerre de béton blanc annonce l’entrée du musée, en se glissant entre les parois du fort et la façade reconstruite de la maison du Gouverneur. Une rampe talutée, surplombant la terrasse du restaurant conduit à l’étage, où s’ouvre latéralement la salle d’exposition temporaire. Complètement vitrée dans la première esquisse, cette galerie s’est opacifiée pour inverser l’effet de masse du fort et annoncer la thématique du poids soulevé, qui est celle du musée lui-même. Sa façade sur cour comporte trois épaisseurs. La première est formée des ruines reconstruites de l’ancienne maison. La seconde est un mur soulevé, soutenu par des poteaux circulaires, qui se retourne à l’horizontal pour former une longue tablette dégageant ainsi vers le bas une fenêtre en longueur. La troisième complète le système d’épaisseur par une ligne de poteaux supportant une sous-face de toiture décaissée pour laisser pénétrer la lumière naturelle par le haut. A l’intérieur de ce système se trouve une cimaise transversale s’ouvrant comme un triptyque dont le panneau central serait une fenêtre. Cette cimaise fait tourner l’espace de la galerie pour lui offrir brusquement la dimension qui lui manquait: la largeur. Ce simple dispositif est caractéristique de ces petits espaces miraculeux que Ciriani sait introduire pour donner de la générosité à l’ensemble. En-dessous de la galerie, le restaurant s’ouvre vers la cour. Une fine passerelle franchit le mur d’enceinte pour rejoindre le nouveau musée. De ce bâtiment, si l’on est un promeneur du dimanche, on en croit connaître déjà, naïvement, les caractéristiques: une enveloppe très fermée, comportant une courbe qu’un observateur inattentif, pourrait rapprocher de la courbure tant de fois copiée de l’Institut du Monde Arabe, et que traverse de part en part, une faille surmontée d’un étrange capteur de lumière qui semble ressurgir de l’autre côté sous la forme d’un grand portique de béton. De l’extérieur cette traversée est lue comme rectiligne. Pénétrant dans le musée, après avoir fait le tour du fort, on ne comprend pas tout de suite par quelle magie ces salles que l’on s’attendait à voir baignées d’une lumière cryptale, sont resplendissantes de lumière radieuse, ce qui semblait être étroit par rapport à l’axe Nord-Sud, donne l’impression inattendue d’une grande largeur, ce qui paraissait être une banale “rue intérieure” traversant en ligne droite l’édifice, est un formidable dispenseur de lumière et générateur d’espace. Cet élément fondamental du projet donne à la volumétrie simple de l’Historial, une forte dilatation. Le miracle de Peronne est le celui offert par cette figure de spirale carrée qui, non seulement, organise l’espace dans les quatre directions cardinales en le soulevant dans un mouvement ascendant, mais produit dans son propre centre un nouveau lieu qui n’était pas lisible de l’extérieur et dont la présence donne à la totalité du musée, une grandeur inattendue. C’est dans l’écartement croisé des deux axes que s’installe cet espace insoupçonné. Appelée Galerie des Portraits, cette pièce ne reçoit sa lumière que de la lumière des autres salles. Elle est à l’intérieur du programme architectural et muséographique, l’instant poignant, le moment d’intense émotion, alors que les salles de la périphérie s’ouvrent plutôt à la pensée et à la réflexion. La définition de cette salle a fait l’objet d’un travail considérable avant de lui trouver cette qualité émotionnelle. Les cimaises des portraits étaient à l’origine dans une relative continuité avec le reste du bâtiment, soulevées en drapeau autour de l’espace central pour former des alcôves liées aux parois. Prenant au fil des esquisses plus d’indépendance, ces cimaises sont devenues des objets verticaux autonomes, alors que la salle elle-même, d’abord pensée comme un espace très différencié, assombri par un plafond noir, se rattache finalement plus ouvertement aux autres salles. C’est dans la progression de ce travail que se trouve la grandeur de l’architecte. En perdant leur image de mobilier, les portraits ont gagné une inoubliable densité, puis ne pouvant, à cause des surcharges, les réaliser en acier plein, résonnant avec le visiteur dans un dialogue physique comme le font les sculptures de Richard Serra, Ciriani va utiliser magistralement ce qui est la densité même de la pensée architecturale: l’échelle. Le rapport au corps, ne se fait plus dans la résonance invisible de la matière, mais dans la vibration purement abstraite de la dimension. Ces stelles verticales sont des condensateurs qui absorbent l’espace virtuel dans leur épaisseur. Ici, que l’on soit promeneur du dimanche ou architecte cultivé, on s’arrête. Après un temps, l’on est attiré par l’écartement proposé entre la densité des stelles et la lumière offerte par les grandes fenêtres s’ouvrant sur les quatre pièces périphériques. Entre les deux sont installés des meubles présentant une série de dessins d’Otto Dix et servant de masque vis à vis des salles voisines. La lumière de celles-ci apparait scandée par les poteaux, quatre au Nord, trois au Sud, deux à l’Est, qui prennent tous dans la profondeur une nuance différente. Dès la première salle d’exposition celle qu’accompagne le mur d’enceinte, on longe les trois éléments qui vont donner la mesure au bâtiment: le poteau, l’aérateur et la fenêtre, à eux trois, ils constituent le langage architectonique de base. Au delà d’eux, les briques du fort forment une toile de fond. Le travail de composition se déroule, accompagné par cette “basse continue” spatiale. L’avancement des esquisses montre une mise au point minutieuse de chaque vue et leur examen fait comprendre que les efforts de Ciriani tendent tous vers la continuité. Les parois se plient et se retournent pour passer d’une façade à une sous-face, d’un plafond horizontal à une paroi verticale. C’est le deuxième miracle de Péronne: l’espace continu. Ici, c’est non seulement les surfaces qui se lient entre elles mais aussi les volumes de vides lumineux qui se déplient en continu en suivant la spirale carrée. Ces vides installent une complète substitution entre le dedans et le dehors, sans pour autant établir des rapports liés à la vue d’un paysage extérieur. Ce que Ciriani semble vouloir dire par cette continuité d’un dedans et d’un dehors réduite à une pure captation d’espace lumière, c’est que la relation moderne entre l’intérieur et l’extérieur peut être bien plus fondamentale que l’habituel et romantique lien pictural d’un site naturel cadré par un volume architectural. Ici, à petite échelle, comme dans ses recherches récentes, en particulier dans la deuxième version des tours de Groningen, Ciriani développe la capacité de l’architecture à intérioriser l’espace du dehors, à lui donner l’équivalent de la qualité d’une pièce intérieure. Cette captation du vide peut se faire même lorsque l’on est confronté à des changements de dimension qui obligent à l’abandon du langage urbain traditionnel, la rue et la place. C’est ce qui est fait ici, à l’échelle d’un petit bâtiment. Par exemple, certains linteaux positionnés très bas dans l’altimétrie du musée comme celui séparant les deux dernières salles sont en réalité des terrasses extérieures, faisant pénétrer le dehors, là où on ne l’attend pas. Ciriani poursuit cette idée avec une pointe d’humour lorsqu’il ouvre une percée vers l’étang à travers le plancher de la salle de conférence, ne laissant voir de l’eau qu’un miroitement de lumière qui rejaillit le long du mur. A la fin de cette promenade intérieure, on découvre comme si on ne l’avait jamais vu, l’horizontale du paysage, que le bâtiment tout entier nous présente en se soulevant par respect, comme on soulève son chapeau. Là, près de la cafétéria on peut s’assoir dans l’alcôve du “banc des amoureux » ou sur le muret déposé près du talus et regarder le double poteau sous le mur courbe pour méditer longuement sur la question: Pourquoi le poteau incliné prend-il son appui sur la courbe du poteau vertical , plutôt que sur le sol ?


















